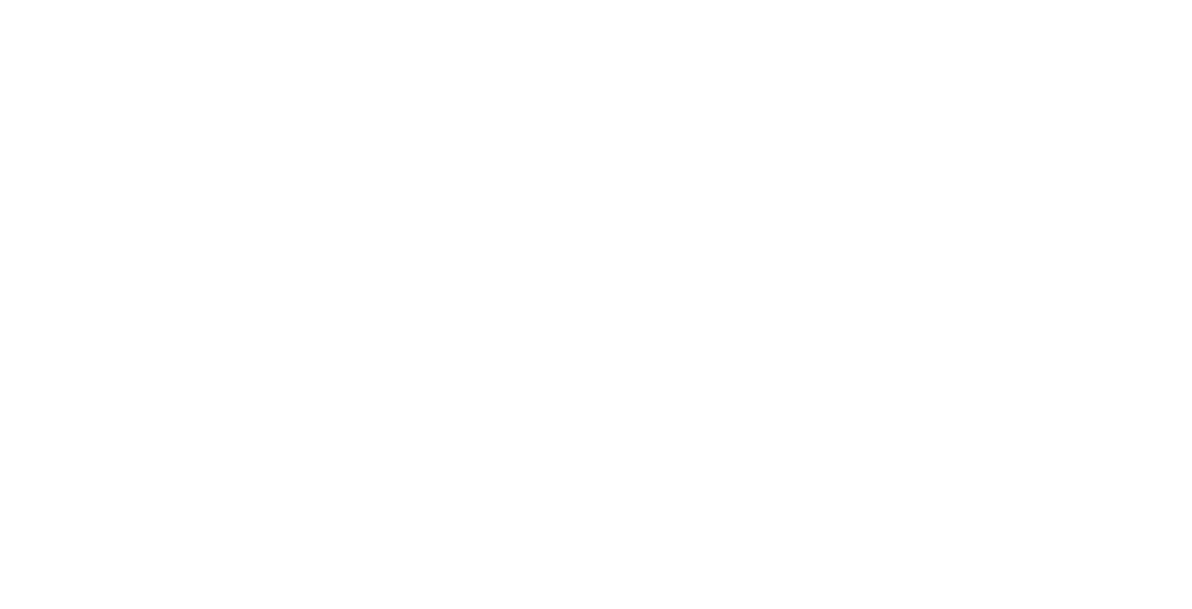Les tanneries et mégisseries françaises sont soumises à l'obligation de classification pour la protection de l'environnement (ICPE). En conséquence, elles doivent contrôler les rejets d'eau, de solvants et de déchets solides.
CTC se propose de vous conseiller dans la mise en place, le prélèvement et la mesure de vos points de rejet.
L'ensemble des prestations de CTC est accrédité COFRAC, ce qui garantit la fiabilité du processus et une réponse adaptée aux exigences des différentes réglementations et collectivités locales, telles que les agences de l'eau.
Au-delà des services de prélèvement et d'analyses, CTC se positionne comme un acteur et un partenaire engagé pour accompagner la transition écologique et énergétique dans la filière cuir. Nous vous aidons à analyser vos problématiques environnementales, à faire un point de situation, et à mettre en place des solutions visant à réduire vos impacts environnementaux.
Renseignez-vous
Quels sont les rejets en tannerie-mégisserie ?
Les incidences sur l'environnement sont liées aux rejets liquides, solides et gazeux et à la consommation de matières premières, telles que les peaux brutes, l'énergie, les produits chimiques et l'eau.
Les principaux rejets vers le système d'eaux résiduelles résultent des opérations par voie humide liées au travail de rivière, au tannage et au corroyage. Les rejets dans l'atmosphère sont dus principalement aux procédés de finissage à sec, mais des émissions gazeuses peuvent aussi provenir des systèmes de production de chaleur.
Les principales sources de déchets solides issus du process sont l'écharnage, le refendage et le dérayage.
Les boues d'épuration des effluents sont une autre source potentielle de déchets solides lorsque le traitement des effluents est réalisé in situ. Certains de ces déchets peuvent cependant être classés comme sous-produits, car ils peuvent être vendus en tant que matières premières à d'autres branches d'activité.
Que trouve-t-on dans l'eau ?
La fabrication d’un cuir à partir d’une peau brute consiste à traiter cette dernière dans une succession de bains de compositions chimiques différentes, en premier lieu, afin de la débarrasser de ce qui est superflu, ensuite, de lui conférer les propriétés caractéristiques des cuirs (imputrescibilité, souplesse, teinte, etc.).
La pollution induite est donc générée à la fois par la peau elle-même et par les réactifs incomplètement absorbés. Les effluents de tannerie comportent généralement une charge dite organique (liée majoritairement aux étapes de rivière) et une charge minérale (liée aux phases de tannage/retannage utilisant du sulfate de chrome comme agent tannant).
Quelles analyses pour une tannerie mégisserie ?
Le cadre réglementaire associé à l’activité de tannerie-mégisserie est celui des installations classées pour la protection de l’environnement, et plus particulièrement celui de la rubrique n°2350.
La surveillance de la qualité des rejets aqueux est une thématique essentielle pour cette activité. Les paramètres de pollution faisant l’objet de surveillance sont formalisés dans les arrêtés préfectoraux d’autorisation des entreprises, en se basant sur les prescriptions de l’arrêté ministériel du 02 février 1998.
Par ailleurs, la majorité des installations existantes, disposant ou non de système in situ de prétraitement des effluents, sont reliées au réseau municipal de collecte d’eaux usées. À ce titre, des paramètres de surveillance complémentaires peuvent exister et sont formalisés dans une convention de rejet entre l’entreprise et la ville.
Il n’existe donc pas une liste type de paramètres applicables à surveiller, si ce n’est quelques paramètres les plus communément rencontrés : DBO5, DCO, Matières en suspension, Chrome total, Métaux totaux, pH, Sulfure, Azote global, Phosphore total.
Quelles sont les dernières évolutions réglementaires ?
Un arrêté du 23 août 2017 a modifié les prescriptions de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, pour prendre en compte le retour d’expérience de la campagne nationale appelée RSDE (recherche de substance dangereuse pour l’environnement), que la France a menée au début des années 2000 pour se mettre en conformité avec la Directive européenne Cadre sur l’eau (2000/60/CE).
Les conséquences de cette modification, pour certaines tanneries et mégisseries soumises au régime d’autorisation, peuvent se traduire d’une part par l’évolution des modalités de surveillance de leur rejet, et d’autre part sur l’ajout de nouvelles substances à surveiller : par exemple, à partir du 1ᵉʳ janvier 2020, la substance « 4-Chloro-3-méthylphénol » a fait l’objet d’un nouveau seuil réglementaire fixé à 150 µg/litre (si le flux > 5 g/jour).
Contactez nos experts